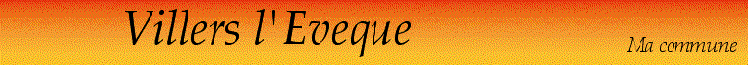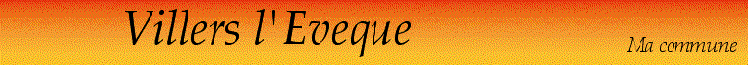Henry DU MONT (1610-1684)
Henry DU MONT (1610-1684)

Henry de Thier naquit à Villers-l'Evêque, près de Liège , en 1610. Il reçut sa première éducation musicale à la collégiale de Maëstricht en tant qu'enfant de chœur. Cependant, très tôt, il sentit la nécessité d'approfondir ses connaissances. Aussi, se déplaça t'il souvent à Liège, alors principauté épiscopale de langue française, afin de profiter des conseils de Léonard Hodemont. C'est probablement lors de son établissement à Paris, entre 1638 et 1640, qu'il adopte le patronyme de Du Mont, traduction française du nom wallon "de Thier". Il ne tarde pas à faire reconnaître son talent, et, dès 1643, il semble tenir les orgues de l'église Saint-Paul (aujourd'hui détruite). Vers 1652, il devient claveciniste de la Chambre du Duc d'Anjou, puis, en 1660, de la jeune reine Marie-Thérèse. Sa consécration survient en 1663 quand il entre en fonction à la Chapelle royale de Versailles comme Sous-Maître, en compagnie de Pierre Robert. A ce titre, s'ajouteront ceux de Compositeur de la Chapelle (1672) et de Maître de musique de la reine (1673). Il céda successivement ces deux postes en 1681 et en 1682. Du Mont avait épousé en 1653 la fille du bourgmestre de Maëstricht, Mechthilde Loyens. Devenu veuf, on lui octroya l'important bénéfice de l'abbaye de Silly, en Normandie. C'est en 1683 qu'il prit sa retraite en se démettant de ses fonctions à la Chapelle royale (Pierre Robert fit de même). Il n'en profita que peu de temps ; il s'éteignit à Paris le 8 mai 1684.
En dehors de quelques chansons et pièces instrumentales contenues dans un volume de Meslanges à II, III, IV et V parties, avec la basse continue (1657), l'œuvre de Du Mont est essentiellement sacrée. Il publia successivement : Cantica sacra (1652) ; Airs à 4 parties avec la basse continue ... sur la paraphrase des psaumes (1663) ; Motets à deux voix avec la basse continue (1668) ; Cinq Messes en plain-chant musical (1660) ; Motets à deux III et IV parties, pour voix et instruments, avec la basse continue (1681). Après sa mort, en 1686, Ballard édita, en parties séparées, le plus important de tous les recueils du compositeur, ainsi intitulé : Motets pour la Chapelle du Roy, mis en musique par Monsieur Dumont Abbé de Silly, et Maistre de la Musique de ladite Chapelle... Imprimez par exprès commandement de Sa Majesté. De plus, la Bibliothèque Nationale, à Paris, conserve quelques ouvrages manuscrits parmi lesquels on distinguera tout particulièrement le Dialogus de anima, seul véritable oratorio du maître.
On remarquera que toutes ses oeuvres comportent la basse continue. Mais au contraire de ce qu'il soutenait, il n'est pas l'introducteur de la basse continue en France. Le procédé y fut exploité antérieurement. Cependant il est vrai que, le premier, il publia une partie séparée de basse continue dans des motets et qu'il contribua pour beaucoup à répandre cet usage. Par contre, il semble bien qu'il inaugura le genre du petit motet français à deux ou trois voix.
Parmi ses ouvrages, seules les Cinq Messes en plain-chant musical, dites "Messes royales", traversèrent les siècles. En effet, Du Mont prit part à l'établissement de la liturgie gallicane mise sur pied en deux étapes, 1662 et 1682. Néanmoins, ces monodies, qui furent chantées jusqu'au milieu du XXe siècle, ne permettent évidemment pas de saisir le style du compositeur. Pour s'en imprégner il est nécessaire d'aller au meilleur de son œuvre: ses petits et grands motets.
Les grands motets de Du Mont furent conçus pour la Chapelle royale. Ils appartiennent à la première époque du genre. Cela implique que, a priori, ils ne se structurent pas en une succession de mouvements définis exploitant chacun une thématique une tonalité, une instrumentation et un effectif indépendants. Le pointillisme du XVIIIe siècle, qui consiste à isoler musicalement les principales idées contenues dans chacun des versets d'un texte n'est pas d'usage. Il ne faut pas croire pour autant que les grands motets de Du Mont adhèrent au monolithisme. Si chaque fin de verset ne se matérialise pas par une double barre de fin, le musicien sait opposer ou associer les idées. Chaque message délivré par le poème possède souvent son caractère propre. Chez Du Mont, mesures différenciées entraînant un tempo particulier se succèdent. Le contraste est l'un de ses soucis permanents. Il se concrétise plus particulièrement dans l'agencement de ses principaux éléments sonores. Solistes, ensembles de solistes, petit chœur, grand choeur et orchestre s'assemblent, se décalent, se répondent en écho, se dispersent, se rejoignent pour créer une architecture sonore horizontale qui ressemble souvent à un jeu de lumière où ombre et éblouissement nous saisissent tour à tour.
Pulsate Tympana, Domine quid multiplicati sunt, Benedic anima mea et Magnificat appartiennent au recueil posthume édité en 1686 tandis que Nisi Dominus n'existe qu'à l'état de manuscrit. Ces cinq grands motets possèdent un point commun. Ils font appel au même orchestre à cinq parties réelles ainsi structuré :
1er dessus de violon
2e dessus de violon
haute-contre de violon
taille de violon
basse de violon et b.c.
Cet agencement orchestral se particularise par la présence de deux parties distinctes de violon impliquant l'utilisation de deux parties d'alto (haute-contre et taille de violon). Ceci vaut la peine d'être relevé car il prouve que Du Mont résista à l'influence de Lully qui utilisait une seule partie de violon et trois parties d'alto. Peut-être était-ce, de la part de Du Mont, une certaine manière de renouer avec ses origines. En effet ce type d'orchestre s'utilisait en Allemagne du Nord dont l'influence devait se faire sentir jusque dans l'ancien pays de Liège qui appartenait au Saint-Empire.
Ces grands motets nécessitent la présence d'un grand choeur toujours constitué des cinq mêmes registres : dessus, haute-contre, haute taille, basse taille et basse. Lorsque les solistes s'unissent, ils forment un petit chœur dont la concision et le volume réduit viennent s'opposer à l'imposante masse du grand chœur, telle une miniature face à une fresque. Le cas du Magnificat est particulier. Il réclame officiellement un grand chœur et un petit chœur à cinq parties dans lequel le registre de bas dessus se substitue à celui de haute-contre. De plus, des solistes émergent du petit chœur. Ceci détermine un appareil choral tridimensionnel, chaque ensemble se caractérisant par son poids et sa couleur sonores. Cette polychoralité possède évidemment le parfum de l'Italie et si, en quelques endroits des quatre premiers grands motets cités, on ne peut s'empêcher de penser à Carissimi ou même à Monteverdi, le Magnificat possède en plus l'éclat d'un feux d'artifice gabrielien. Mais à l'Italie ne reviennent pas seulement des problèmes d'architecture chorale. Toute la musique de Du Mont est emplie de tournures harmoniques, de formules de cadences, de mélodies violonistiques importées d'Outre-Monts. Tous ces éléments, il les a digérés, maîtrisés, intégrés à sa personnalité. En les associant à une prosodie claire et à des phrases récitatives dignes de Lully, il s'est forgé son propre style, celui d'un des plus grands musiciens de son époque.
Il faut encore souligner l'excellence du rhétoricien. En cela il ne cède en rien à Marc-Antoine Charpentier, André Campra ou Michel-Richard de Lalande. Un passage tel que celui établi sur le mot "dispersit" du Magnificat, où la dispersion de ceux qui ont des pensées d'orgueil s'illustre par la dispersion des voix, nous le prouve.
Le petit motet In lectulo meo pour deux voix et basse continue, basé sur la technique vénitienne de l'écho, ainsi que le O Panis angelorum à quatre voix et basse continue, de conception plus verticale, appartiennent aux Cantica Sacra publiés en 1652. Le succès fut tel que ce recueil connut une seconde édition dix années plus tard.
Vous pouvez écouter quelque symphonie en cliquant ci dessous :
1 ère symphonie
2 eme symphonie
3 eme symphonie