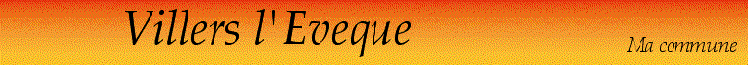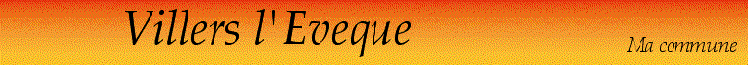L'architecture.
L'architecture.
 Les cloches.
Les cloches.
 Les peintures.
Les peintures.
 Les vitraux.
Les vitraux.
 La confrérie.
La confrérie.
 La sculpture.
La sculpture.
 L'architecture
L'architecture
Jusqu'en 1886, l'église de Villers conservait encore des parties bâties en moellons (XIII - XIVe s.) : une tour carrée dont la face ouest avait été renforcée au XVIIe s. par un épais parement servant de contrefort, le dernier étage en brique étant un ajout du XVIIIe s.; ainsi qu'un transept saillant et un choeur à chevet plat ayant gardé sa baie d'origine à 3 lancettes. Les bas-côtés et la sacristie basse appuyée contre le chevet, en pierre et brique, dataient probablement de la fin du XVIe s.
Devant faire face aux réparations qu'exige un édifice de cette époque, il fut fait appel à l'architecte Hubert Froment afin de construire une nouvelle église. La taille de la construction projetée (1000 places) ne permit pas sa réalisation. Sous l'influence du président du conseil de fabrique Lhoest, on se tourna vers une solution de compromis : restaurer le choeur et le transept en vue de leur classement et procéder à la construction d'un vaisseau néo-gothique à trois nefs de cinq travées, flanqué au sud par une tour dont la partie supérieur est octogonale.
Malgré les difficultés financières et les oppositions, le 16 mars 1891, les travaux de démolition commencèrent. Le 27 avril suivant, le curé Béchet recevait son doyen, le curé Speder de Horion Hozémont, pour bénir la première pierre.
La nouvelle église fut consacrée par Monseigneur Doutreloux, évêque de Liége en 1893. Elle est dédiée à la Sainte Vierge, comme l'atteste le chronogramme gravé sur le linteau de la porte d'entrée.
 Les cloches
Les cloches
Le 28 janvier 1900, le doyen Speder et le chanoine Bronckart sont venus procéder au baptême d'une cloche refondue par Mr Vanaerschodt de Louvain. Elle pèse 490 kg et porte le nom de Marie Immaculée. Sont parrain et marraine Mr Jospeh Dormal et Mme Agnés Bodson. Cette cloche fut emmenée par les allemands le 10 juillet 1943.
Deux autres cloches se trouvent dans la tour: une de 1659 qui pèse 700 kg et une de 1700 qui pèse 1000 kg.
Dans le choeur se trouve une cloche qui vient de la maison Batta, face à l'église. Elle fut donnée par T.Milisen et placée par le maréchal V.Ramaeckers. Elle pèse 6,1 kg et sonna la première fois le 5 avril 1936, dimanche des Rameaux.
 Les peintures
Les peintures
En dehors de quelques maigres fragments de peintures anciennes conservées au chevet du choeur, toute la décoration est l'oeuvre de l'artiste liégeois Adolphe Tassin (Antheit 1852 - Wasseiges 1923), auteur d'une quarantaine de travaux dont certains de grande envergure, situés en région liégeoise (cathédrale Saint-Paul, basilique Saint-Martin, église Saint-Louis,...), hutoise (collégiale Notre-Dame), limbourgeoise (Bocholt, Bree, Lommel,...), verviétoise (Pépinster, Hodimont) et même exceptionnellement à l'étranger.
Dés 1893, le curé de Villers l'évêque, l'abbé Bechet, fait appel à Tassin pour la décoration de sa nouvelle église. Il s'agit dans un premier temps de motifs décoratifs sobres et dépouillés - semis, imitation de briques, fleurs de lis, draperies, inscriptions- destinés à orner la voûte et les murs. La correspondance échangée entre le curé et l'artiste nous livre des indications très précises et intéressantes sur le coût de ces travaux réalisés il y a un siècle: 70 centimes le métre courant d'inscription, 125 le mètre carré de draperies!! Cette première phase des travaux, non entièrement conservée, aura coûté au total 1096 frs.
Plus importantes sont les peintures historiées, dont Tassin est chargé en 1912 et qui, contrairement à d'autres ensembles comme ceux de la basilique Saint-Martin, sont dans un bon état de conservation.
Dans la nef principale, au dessus des colonnes, unes série de saints sont représentés sur des socles avec leurs attributs: saint Pierre, saint Lambert, sainte Anne éduquant la Vierge enfant, saint Martin partageant son manteau, au nord, saint Paul, saint Jean-Baptiste, sainte Julienne de Cornillon, saint Roch au sud.
A l'entrée du choeur, l'arc triomphal est entièrement recouvert par un jugement dernier. Le Christ de l'Apocalypse siège au centre sur la voûte céleste, serrant dans la bouche l'épée et le lis. Il est entouré d'anges musiciens, de la Vierge et de saint Joseph en prière. A sa droite se tiennent les élus, à sa gauche l'archange saint Michel opère la pesée des âmes tandis que les damnés sont précipités en enfer.
Enfin, au chevet, un couronnement de la vierge sur un fond bleu étoilé surplombe les figures de saint Hubert et de sainte Catherine, la scène se déroule en présence d'anges musiciens. Empreint d'une certaine fraîcheur de coloris et d'une sérénité notamment dans l'attitude recueillie des personnages, cette composition, très représentative de l'art de Tassin, traduit de façon éloquente l'influence de la peinture italienne du Quattrocento, et plus particulièrement de Fra Angelico pour qui Tassin avait une admiration profonde. Le couronnement de la Vierge, thème cher à l'artiste et que l'on retrouve à plusieurs reprises dans son oeuvre, s'inspire directement des fresques du couvent de Saint-Marc prés de florence.
En dehors de cet ensemble, le patrimoine pictural de l'église est assez restreint.
Réalisé en 1860 à la demande du curé Doudlet, un chemin de croix fort sombre est dû à Isidore Lecrenier (1823 - 1889), artiste hutois au talent inégal. Du même auteur, deux panneaux allongés représentent une Visitation et une Adoration des bergers. Ils furent acquis en 1866 grâce à l'intervention de la confrérie de la sainte Vierge et destinés à orner les autels lors des grandes fêtes.
Notons encore une copie ancienne (XVIIe s.) de la célèbre Dispute du saint Sacrement de Raphael, provenant vraisemblablement de la collégiale Saint-Paul à Liége dont les chamoines d Saint-Materne étaient décimateurs.
Enfin, une adoration des bergers attribuée à Jean de Fraipont ne manque pas d'expression malgré d'évidentes maladresses dans les proportions et les attitudes (par ex. l'ange de droite). Ce tableau peint sur toile vers 1642-43 provient du retable de la chapelle du Tiège aujourd'hui disparue. Il est actuellement en dépôt au Musée d'Art Religieux et d'Art Mosan.
 Les vitraux
Les vitraux
Contrairement aux peintures murales, les vitraux sont de l'oeuvre de deux artistes différents. La verrière qui orne le chevet du choeur est réalisée par la maison Hemptinne de Gand vers 1898; elle représente saint Simon Stock recevant le scapulaire, la vierge et l'enfant remettant le rosaire à saint Dominique et une Assomption.
Les vitraux du transept, de la nef et du jubé sont confiés à la célèbre maison Osterrath de Tilf dont les ateliers fondés en 1872 par joseph Osterrath père poursuivront leurs activités durant plusieurs décennies. Leur production est particulièrement féconde à en croire la quantité impressionnante de dessins, projets et dossiers conservés au Maram.
A villers, les premiers contacts sont pris avec J. Osterrath fils par le curé Grégoire dès 1905, mais il faudra encore attendre seize ans pour que son successeur, le curé Péry, guidé par le directeur de l'école Saint-Luc à Liége, réclame projets et devis pour les fenêtres du transept;
 La confrérie
La confrérie
L'église de Villers a été de tout temps dédié à la Sainte Vierge. Une confrérie y existe : La confrérie de la Mére Dieu, connue de nos jours sous le nom de confrérie de Notre-Dame et de Sainte Elisabeth (de Hongrie).
Son origine remonte au XVe s.; dans un acte de la cours de justice d'Odeur, daté du 6 juin 1457, un "honeste hôme Johan Collard de Villers " signe en qualité de Mambour de la " confraternité delle Mère Dieu".
Cette confrérie est ratifiée et approuvée par l'évêque Jean de Hornes le 27 juin 1503. Le prince évêque Evrard de la Marck la confirmera le 21 février 1528 et le Pape Paul V la confirmera par une bulle, le 16 avril 1616.
Deux siècles plus tard, Pie IX accordera que l'indulgence plénière réservée au jour de la fête de la Visitation, soit étendue à tout l'octave.
Cette société était présidée par un des serviteur-prete, autre que le pretre du village et élu pour un an, par les confréres réunis en assemblée à la saint Etienne. Ils fixent également ses obligations et sa rétribution. Parmi ses obligations, il doit assister aux offices et aider le curé, confesser les malades et célébrer cinq messes par semaines pour les confréres.
Deux maîtres nommés à vie, veillaient à la bonne organisation de la confrérie.
Pour être confrére, il fallait s'engager sa vie durant à payer, chaque année, trois livres.
Les status traitent de l'assistance aux offices, des funéailles des confréres, ect...
Le 2 juillet, fête de la visitation et de la confrérie, devint jour de kermesse. Ce jour-là, on allait chanter la messe dans la chapelle de Mére Dieu au Tidge, y prendre la chandelle et, en procession, on revenait à l'église chanter une seconde grand'messe et faire encore une procession. Procession pittoresque, avec ses bannières, ses ménétriers, un clergé nombreux et entourant la statue de la Vierge, les confréres portant le "chapiron", capuchon habillant la tête et le cou jusqu'au épaules, les consoeurs avec des ceintures multicolores et des flouches, les maîtres de confrérie avec leurs insignes.
Aprés les ceremonies religieuse, il y avait la fête, dîner en commun des menbres et récréation aux frais de la confrérie.
La cire et les cierges ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations de la confrérie : dès 1625, on s'engageait à fournir annuellement des livres de cire. A partir de 1750, on assiste au rachat de cette rente de cire. Cette coutume dura jusqu'en 1849 quand le curé Doudlet décide d'offrir la chandelle. Ce système favorisait les nantis. Pour éviter cela, le doyen Tummers revint, dans l'esprit des anciens statuts de la confrèrie, en permettant à chacun de d'offrir une part de la chandelle, qui finalement est tirée au sort.
 La sculpture
La sculpture
La sculpture est qualitativement et quantitativement bien représentée, depuis le XVe s. jusqu'au XVIIIe siècle.
La pièce la plus ancienne est un grand Christ gothique en chêne, qui figurait à l'origine sous l'arc triomphal de l'ancienne église.
D'après le curé Fréson, il fut déplacé à plusieurs reprises lors de l'acquisition du nouveau christ en plôtre vers 1670, il fut mis à l'abri dans une école pour éviter sa démolition suggérée par le curé Doudiet; en 1890, il fut replacé sur la paroi nord de la nouvelle église, exposé aux intempéries,
jusqu'au passage du professeur Brassinne qui le remarqua et le fit mettre à l'abri dans le parvis; actuellement, il orne le mur nord du choeur. Ce corpus de christ présente une téte légérement inclinée ceinte d'une couronne d'épines, encadrée de deux longues et fines mèches torsadées, les bras tendus ouverts en V, la cage thoracique très marquée, de manière excessive les pieds superposés, le droit sur le gauche, fixés par un seul clou, le périzonium drapé en lange, retenu latéralement par un large noeud. Il s'en dégage une impression de rigidité, d'hiératisme et d'expressivité due à l'accentuation du rendu anatomique, en particulier au niveau des coudes et des veines.
Du XVIe s., signalons une statue de sainte Gudula, représentée avec un livre ouvert et son attribut, la lanterne allumée que s'efforce d'éteindre à l'aide d'un soufflet le diablotin disposé à ses côtés. Elle est en dépôt au MARAM depuis 1981; il en est de môme pour deux statues du XVIIe s., une Vierge et un saint Jean de Calvaira(non exposé), d'allure massive et de facture assez naïve; en témoigne le systémat.isme des drapés. Ces oeuvres indiquent la survivance des modèles gothiques au-delà encore du début du XVle s.
Provenant de la chapelle du Tige, un saint Materne sur son socle d'origine (XVI le s.) l'évôque est représenté debout, une croix dans la main droite, l'autre attribut (une maquette d'église) ayant disparu; un saint Roch (XVIIe s.) accompagné de ses attributs iconographiques la pélerine et le chapeau timbrés de coquilles, le chien qui chaque jour lui apportait son pain et l'ange montrant le bubon pesteux; un saint Sébastien (XVIIIe s.) au corps déhanché adossé à un tronc d'arbre.
S'y ajoute un groupe de sculptures qu'il convient de rattacher au courant de l'école baroque liégeoise et principalement à l'esthétique delcourienne : saint Antoine de Padoue revétu de la bure ceinte d'une corde à noeuds, tenant de la main gauche un lis (disparu), et de la main droite un livre ouvert sur lequel se dresse l'enfant.
Attribué au liégeois Jacques Vivroux (1703-1777), un saint Hubert, d'un baroque tempéré, représenté avec ses ornements épiscopaux, la mitre, la chape et le surplis, en présence du cerf crucifère dressé à ses côtés. Le mouvement créé par le pan droit de la chape ramené en tablier ~ar la main gauche est conforme aux schémas exploités par Jean Delcour et ses nombreux imitateurs. Devant l'autel latéral sud, une statue de saint Joseph portant l'Enfant sur le bras gauche, à rattacher également à l'école liégeoise. pendant de ce dernier, au-dessus de l'autel latéral nord, une Vierge mannequin habillée, parée de couronne et sceptre en argent
(1787).